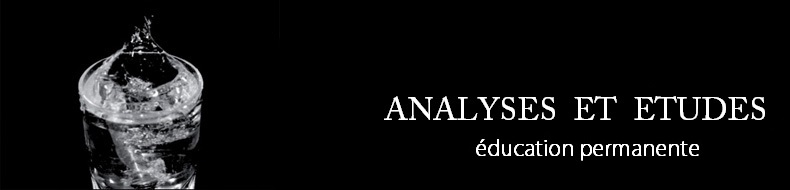1. Rappel
Nos travaux dans le secteur de l'éducation permanente s'inscrivent dans la dynamique d'un programme de recherche qui identifie des pôles d'exploration et des points de vue et objets qui y correspondent.
Ce programme a fait l'objet d'une publication en 2006.
Pour rappel, ce programme de recherche identifie quatre pôles à explorer :
- le pôle de l'adversaire, où nous nous efforçons d'identifier et d'analyser les visages contemporains de la domination; une hypothèse structurante est que cette domination prend la forme d'une «institution totale virtuelle», s'attaquant à l'autonomie culturelle des sujets et aux formes collectives de lutte et d'association;
- le pôle de la résistance concerne les initiatives diverses, qu'elles soient plutôt sociales ou plutôt culturelles, qui ne se satisfont pas de l'ordre des choses; les associations (que nous appelons «institutions» en référence au courant institutionnaliste dont nous tentons de recomposer les apports) y jouent un rôle central;
- le pôle de l'acteur concerne deux dimensions : la première pose la question de l'identité de l'ensemble (au moins théorique) que composent les associations, dont nous pensons qu'elles jouent un rôle déterminant dans la production de la société d'aujourd'hui ; il convient de se demander si une conscience de ce rôle existe ou à quelle condition elle peut se développer; la deuxième dimension identifie, à la suite de Callon et Latour, les «créatures» (les inventions de laboratoire, techniques ou conceptuelles) qui façonnent notre quotidien d'une manière déterminante;
- le pôle du modèle invite à réfléchir à la production de la société, au modèle de développement qui l'oriente, aux controverses qui le traversent, sachant qu'un tel modèle réunit des acteurs en conflit, qui se rejoignent sur une direction (par exemple le Progrès par l'industrialisation, ou le développement durable) et s'opposent sur son interprétation.
Comme l'année précédente, nous rendons compte de nos travaux en les situant par rapport au pôle principal qu'ils ont choisi d'explorer.
2. Description de nos productions
Nos travaux relatifs au pôle de l'adversaire
A- LES AVATARS D'UNE «INSTITUTION TOTALE VIRTUELLE»
Nous avons consacré plusieurs travaux à la dimension immatérielle de la domination, notamment telle qu'elle s'exprime dans le champ médiatique. Il est vrai que l'année 2006 fut particulièrement interpellante à ce sujet (docu-fiction de la RTBF, élections françaises hyper-médiatisées, élections en Belgique, etc.).
Analyse n° 1 - Hypothèses sur la domination dans la société de l'information
Analyse d'initiative - Jean Blairon et Emile Servais, newsletter du 1-02, 9292 caractères
Ce texte présente un modèle d'analyse de la domination culturelle inspiré des travaux d'E. Goffman à propos des «forceries culturelles» : les procédés de «désintégration du moi» dont Goffman avait identifié l'efficace dans les institutions totales sont repérés, mutatis mutandis, dans une société de l'information mondialisée.
Analyse n°2 - Confinement du champ politique et destruction du sens, une analyse du discours d'investiture de M. Nicolas Sarkozy de Nagy-Bocsa
Analyse d'initiative - Jean Blairon et Emile Servais, newsletter du 1-02, 27864 caractères
Cette analyse tente d'élucider le «régime de sens» utilisé par le candidat Sarkozy pour tenter de s'imposer médiatiquement; le texte essaie aussi d'analyser les effets possibles de ce type de pratique langagière.
Analyse n° 3 - L'immodestie et l'appauvrissement, quelques commentaires sur le prétendu docu-fiction de la RTBF
Analyse d'initiative - Jean Blairon et Emile Servais, newsletter du 1-02, 15590 caractères
L'émission «Bye Bye Belgium» indique un «passage de seuil» fatal, malheureusement effectué avec orgueil par la chaîne de service public. Sa prétention à «réveiller» l'opinion publique indique une transformation profonde de la conception du rôle des médias, mais aussi l'alignement massif de la RTBF sur des logiques de concurrence dont son statut d'entreprise de service public aurait dû la tenir éloignée...
Analyse n°4 - Quelques balises pour soutenir les enjeux d'égalité et de liberté dans la société de l'information
Analyse communiquée dans le cadre des «Chantiers pour demain» organisés par la Fédération namuroise du Parti Socialiste - publication diffusée auprès des animateurs du chantier et diffusée dans le n° d'avril d'Intermag - Jean Blairon 16023 caractères
Les «Chantiers pour demain» souhaitaient réfléchir notamment à l'impact des nouvelles technologies sur la vie des citoyens, en matière d'égalité et de liberté. Nous avons participé aux débats et publié un argumentaire qui soutenait nos prises de position en la matière, notamment à propos du «Jobpass» imposé aux demandeurs d'emploi en Wallonie. Ce texte a débouché sur une pétititon appelant au boycot de ce contrôle virtuel, qui réunit le Cesep et le Ciep de Namur.
Analyse n° 5 - Publicité économique et politique et obscénité
Analyse d'initiative - Jean Blairon et Emile Servais, diffusée dans le n° d'avril d'Intermag, 15006 caractères
Nous mettons en oeuvre les concepts élaborés dans la série d'analyses présentées ci-dessus à propos de trois publicités dont nous estimons qu'elles relèvent de la catégorie de l'obscénité telle que la définissait H. Marcuse : une publicité pour VW (après le licenciement de travailleurs à Forest) et deux publicités électorales, dont nous estimons qu'elles font comme la première particulièrement injure à la réalité.
Analyse n°6 - Les besoins des jeunes en matière de loisirs : une affaire de représentation?
Analyse opérée à partir de sollicitations exprimées par des opérateurs culturels et sociaux des régions de Huy et d'Arlon souhaitant mieux définir les politiques culturelles pertinentes pour la jeunesse - Jacqueline Fastrès, diffusion par newsletter en décembre, 19415 caractères.
Ce travail consiste en un commentaire critique et prospectif élaboré à partir d'enquêtes quantitatives et qualitatives réalisées par RTA à propos de la question des loisirs, notamment en région rurale.
B- DOMINATION ET GROUPES SOCIAUX
La domination qui traverse les sociétés contemporaines ne relève évidemment pas seulement de facteurs culturels. Elle possède aussi une composante sociale majeure. Quatre analyses l'illustrent ; deux sont consacrées à la compréhension de la pauvreté ; deux autres (qui inaugurent une série) visent à prendre un recul réflexif par rapport aux pratiques de formation destinées à un public populaire.
Analyse n°7 - La pauvreté : au-delà des chiffres
Analyse n° 8 - Une pauvreté oubliée : les working poors
Analyses d'initiative - C. Bartholomé, diffusion par newsletter en octobre et dans le numéro d'Intermag d'octobre, 16540 et 18072 caractères.
Dans ces deux analyses, l'auteur examine les conditions structurelles qui qualifient et déterminent la situation de pauvreté et il démontre que celle-ci ne se réduit pas à des facteurs strictement économiques. Au-delà de ceux-ci, en effet, la situation de pauvreté se caractérise par d'autres composantes qu'il convient de prendre en compte (assignation d'un statut particulier, lien à l'emploi, liens sociaux, etc.).
Analyses n° 9 et 10 - Classes et cultures populaires : des classes et cultures dominées et stigmatisées?
1. Un dispositif d'exploration
2. Une étude structurelle en référence à Pierre Bourdieu
Analyses d'initiatives menées à partir d'un programme de formation dispensé par RTA au profit de formateurs d'une association d'éducation permanente - Emile Servais et Jean Blairon, diffusion par newsletter en décembre, 10599 et 17099 caractères.
Nous poursuivons ici notre analyse du concept de classe sociale et plus précisément de classe populaire en examinant l'apport que peut constituer une approche sociologique pour aborder la question : quelle politique de formation mener aujourd'hui à destination d' «un public populaire»?
Les deux textes proposent une méthodologie d'exploration participative pour mener à bien cette investigation, puis envisagent l'apport de la sociologie de Bourdieu à ce propos. D'autres analyses complèteront cette approche en 2008 (à partir de la sociologie de Goffman, Boltanski et Touraine).
Nos travaux relatifs au pôle de la résistance
Dans cette partie de notre programme de recherche, nous partons «du bas» pour étudier une série de pratiques qui entendent résister aux effets de domination que nous avons évoqués ci-dessus. L'optique n'est évidemment ni descriptive ni promotionnelle : nous entendons étudier à quoi et comment des «institutions» entendent s'opposer, en regard des effets de domination qu'elles ont identifiés. Même si ces institutions sont plutôt ancrées dans des pratiques culturelles ou sociales, l'examen de leurs pratiques montre que chacune articule, à sa manière, la prise en compte de ces deux dimensions.
Etude n°1 - Evaluation du dispositif «Dérapages» proposé par la Compagnie Arsenic en partenariat avec le Centre d'Action Laïque, Présence et Action Culturelles (PAC),le Mouvement Ouvrier Chrétien (CIEP) et les Territoires de la Mémoire; partie 1 : Une propédeutique de la réalité?
Analyse réalisée à la demande de la compagnie Arsenic - Jean Blairon, diffusion par newsletter en décembre, 63590 caractères, annexe 1 non comprise.
Nous avions publié l'année dernière une analyse proposant une stratégie d'évaluation pour une action culturelle comme celle qui est évoquée ici (analyse reprise en annexe 1). Nous avons mené une partie du travail défini dans ce protocole ; il concerne l'étude critique de la dimension dramaturgique qui est supposée incarner le projet d'éducation permanente que s'est défini la compagnie. En 2008, nous mènerons à son terme une deuxième partie du projet : la confrontation des évaluations réalisées par chacun des partenaires de l'action (dimension sociale du dispositif).
Analyse n° 11 - Faire voir le pouvoir et l'abus de pouvoir, en retournant ce pouvoir contre celui qui l'exerce
Analyse d'initiative - Jean Blairon et Emile Servais, diffusion par newsletter en octobre, 22398 caractères
Ce texte se propose de définir ce que peut être l'activité de recherche en éducation permanente, en rappelant notamment à quel héritage cette activité devrait pouvoir se référer. Il étudie ensuite les nouvelles conditions de production qui sont de mise aujourd'hui et met en garde contre les effets possibles de la domination culturelle en la matière.
Analyse n° 12 - Controverse dans le champ de la culture
Analyse d'initiative - Jean Blairon, diffusion par newsletter en octobre, 10736 caractères
A la suite de nos travaux critiques sur les positions de Bernard Lahire et de notre analyse des pratiques du Miroir Vagabond, nous tentons de structurer les termes d'une controverse qui traverse aujourd'hui de façon massive le champ de la culture. Nous tentons ainsi d'identifier une approche «public» et une approche «population», en montrant comment elles s'opposent point par point.
Analyses n° 13 à 16 - Polymorphisme, paradoxes et dilemmes : les difficultés de la fidélité institutionnelle - le cas des Agences immobilières sociales (AIS)
- n° 13 La dimension historique et politique des AIS
- n°14 La structure de l'environnement : des courants opposés
- n° 15 La structure de l'environnement : les AIS, acteurs de réseau?
- n° 16 La situation des bénéficiaires : l'indexation du sens, la clarté des normes
Analyses demandées par la Fédération des AIS et réalisées sous le mode de l'exploration participative - Jacqueline Fastrès, diffusion par newsletter en décembre, respectivement 18014, 24329, 14169 et 18372 caractères
L'exercice effectif du droit fondamental au logement ne va pas de soi. Les agences immobilières sociales sont issues de dynamiques instituantes et se sont mobilisées, au nom de la critique sociale, pour que ce droit soit accessible à tous. Au moment où ces structures deviennent instituées, elles ont souhaité faire un point critique sur leurs pratiques et leurs orientations communes.
Les textes qui sont publiés étudient celles-ci à partir de plusieurs angles d'approche, mais ils constituent aussi un exemple de ce que peut être une recherche institutionnelle collective, tant au niveau des pratiques que des orientations politiques poursuivies.
Analyse n°17 : «Il faut travailler en réseau!»
Analyse d'initiative - Christophe Bartholomé, diffusion par newsletter en décembre, 19468 caractères
Cette analyse revient sur l'utilisation de la notion de réseau par les professionnels du social. Elle vise à identifier trois formes de réseau généralement envisagées par ces professionnels. Pour chacune de ces formes, l'analyse revient sur les effets constatés en regard de la question de la solidarité collective.
Nos travaux relatifs au pôle de l'acteur
A l'intérieur de ce pôle, deux types d'investigations sont menées en parallèle. La première étudie à quelles conditions un mouvement d'ensemble peut peser sur la définition des orientations qui guident l'action de la société sur elle-même; la seconde étudie de manière critique le rôle que jouent certains «acteurs non humains», soit des «inventions de laboratoires» qui contribuent à façonner notre quotidien.
Dans le premier genre, nous trouvons d'abord deux analyses consacrées à la nature du contre-pouvoir.
Analyse n° 18 - Actions et acteurs du contre-pouvoir : bilan critique et perspectives
Analyse d'initiative - Jean Blairon et Emile Servais, diffusion par newsletter et dans intermag en octobre, 20714 caractères
Nous avons entrepris, en partenariat avec la Fédération Ance, une formation des directeurs d'association à un management qui serait adapté aux dynamiques associatives.
Un des auteurs de référence en la matière est le sociologue Jean-Pierre Le Goff et nous avons souhaité rendre sa pensée accessible au public belge.
Nous avons donc diffusé une longue interview vidéo de l'auteur, qui passe en revue la diversité de ses travaux (interview en trois parties); nous l'avons réalisée à partir d'une analyse de son oeuvre que nous avons opérée à partir de la question du rôle du secteur associatif dans la production de la société (analyse n° 18)
D'autres actions sont détaillées plus loin.
Il est apparu logique de compléter ce travail par une étude du «nouveau management» comme une «créature» (un «acteur non humain»), extrêmement active dans la «modernisation» des sociétés (c'est-à-dire dans l'exercice du pouvoir en son sein). Quatre analyses ont été réalisées en ce sens.
Les deux premières étudient les composantes de cette créature, notamment la nouvelle place qu'elle entend donner aux bénéficiaires. Les deux suivantes s'interrogent sur les raisons du succès de cette nouvelle vulgate dans le secteur associatif, qui semble à première vue avoir tout à perdre à en adopter les logiques : il est en effet curieux de voir le contre-pouvoir singer les (mauvaises) moeurs du pouvoir.
- Analyse n° 19- Les belles promesses du management
- Analyse n° 20- L'émergence de l'usager client
Analyses d'initiative - Christophe Bartholomé, diffusion par newsletter en octobre, 16203 et 21466 caractères
Analyse n° 21 - Les conditions d'une invasion continuée
Analyse d'initiative - Jean Blairon, prise de parole publique à l'occasion de l'invitation de J.-P. Le Goff en octobre, 13235 caractères, diffusion dans le numéro d'Intermag consacré à la conférence de Le Goff en 2008
Le texte s'interroge sur les raisons qui peuvent pousser le secteur associatif à adopter des références qui constituent la négation de son identité.
Analyse n° 22 - Nouveau management et sens du travail : contexte et effets d'une adoption dans le secteur associatif
Analyse d'initiative - Emile Servais, diffusion par newsletter en octobre, 20641 caractères
Ce travail est complémentaire du précédent ; il s'intéresse plus particulièrement aux causes qui relèvent des transformations du champ de la formation et du conseil.
En termes de critiques des effets du nouveau management, enfin, des travaux plus approfondis sont consacrées à des pratiques sociales et culturelles imprégnées par le modèle du néo-management
Analyse n° 23 - Nouveau management et culture des compétences
En complément aux travaux des Assises de l'égalité sur la culture des compétences, nous avons réalisé un dossier consacré à la culture des compétences, constatant qu'une même manière de parler le travail, la formation ou l'enseignement s'est installée un peu partout sous la forme du «modèle des compétences». Avec quels effets: davantage d'égalité ou au contraire la création de nouvelles inégalités?
Analyse d'initiative - Amélie Jamar et Jean-Pol Cavillot, diffusion en avril dans le n°7 d'Intermag, 15610 caractères.
Etude nº2 - L'accompagnement: des postulats et des engagements pédagogiques à sauvegarder
Etude d'initiative - Christophe Bartholomé, diffusion par newsletter en décembre, 73773 caractères
«L'accompagnement» semble s'imposer dans tous les secteurs de l'action sociale et de l'aide aux personnes. Cette belle unanimité masque mal des orientations en sens divers, qui peuvent servir des politiques antagonistes. Cette étude propose, à partir de nombreuses observations de terrain, une série de balises permettant de mieux appréhender les enjeux de ces pratiques pour les bénéficiaires.
Analyse n°24 - L'autorité, une question à appréhender à fronts renversés
Analyse d'initiative - Jean Blairon, diffusion dans le n°9 d'Intermag consacré à J.-P. Le Goff en 2008. Le texte a fait l'objet d'une intervention lors du colloque précité, 20312 caractères
Ce texte fait le point sur le bilan critique des mouvements culturels des années soixante proposé par le sociologue. Il essaie de montrer que les luttes de l'époque doivent s'appréhender aujourd'hui en renversant tous les signes.
Dans un autre domaine, nous avons consacré une étude critique à une autre créature très active aujourd'hui : l'option municipaliste dans les politiques sociales. Nous avons co-organisé (avec le Service Droit des Jeunes de Bruxelles) et animé une table ronde à ce sujet et produisons deux analyses : une analyse transversale des débats qui ont eu lieu et une tentative de contextualisation de l'option municipaliste.
Analyse n° 25 - Synthèse critique de la table ronde «municipalisation du social»
Jacqueline Fastrès, publication dans le n° de décembre du «Journal Droit des Jeunes». Ce texte est réalisé à partir d'un compte rendu des débats, dont il propose une analyse propre.
Analyse n° 26 - Municipalisation du social et luttes cognitives
Analyse d'intiative - Jean Blairon, publication dans le numéro de décembre du «Journal Droit des Jeunes», 21600 caractères
En nous basant sur les travaux de Bernard Noël consacrés à la Commune de Paris, nous établissons toute la différence qui sépare le courant municipaliste de ce qui est supposé l'avoir inspiré : le communalisme.
Nos travaux relatifs au pôle du modèle
Une façon de penser la critique sociale dans une société capitaliste est incarnée par les travaux de Luc Boltanski : le sociologue identifie des «mondes» (des systèmes de sens) qui permettent de doter de valeur une pratique, un comportement, etc.
Nous proposons quatre analyses relatives à cette approche, en espérant qu'elles pourront servir de prélude à une rencontre avec l'auteur; ces analyses tentent d'articuler la sociologie de Boltanski avec l'analyse institutionnelle.
Analyses 27 à 30 - Les institutions confrontées à l'éclatement référentiel
1. La nature du problème
2. Une manière d'intervenir
3. Quatre exemples d'intervention
4. Mondes, controverses et épreuves
Analyses d'initiative - Jean Blairon, parution dans le n° d'Intermag du mois d'avril, respectivement 11269, 17501, 33232 et 12052 caractères.
Enfin, nous sommes revenus sur notre programme de recherche dans une analyse rétrospective, qui donne les orientations que prendront nos activités en 2008 à partir d'une tentative de synthèse des travaux menés ces deux dernières années, en partant d'une question «simple»: y a-t-il un conflit central dans nos sociétés, analogue au conflit qui a opposé patronat et mouvements ouvriers dans la société industrielle?
Analyse n° 31 - Quelle est la lutte, où sont les fronts? Représentations et pratiques du contre-pouvoir
Analyse d'initiative - Jean Blairon et Emile Servais, publication par newsletter en décembre, 15508 caractères.