|
Dossiers et reportages || Questions sociétales
Des luttes pour des droits culturels
|
Introduction
Dans un autre dossier (Droits culturels: Alain Touraine rencontre les acteurs du champ culturel en communauté française), nous proposions un entretien avec le sociologue français Alain Touraine qui posait la question d'une redéfinition des mouvements sociaux. Ainsi, selon lui, après les luttes sociales des dernières décennies, un nouveau conflit central se fait jour dans nos sociétés modernes. On peut en effet clairement identifier de nouvelles luttes très concrètes et de nouvelles résistances émergentes, mais ces luttes apparemment disparates ont-elles une cohérence? Répondent-elles à un modèle particulier? Et quel en est l'enjeu? Illustrations à l'appui, à la lumière de la sociologie du Sujet chère à Alain Touraine, Intermag analyse et décrypte dans ce dossier une série de luttes très concrètes, à la recherche d'une cohérence dans la résistance...
|
L'art d'un continent remixé>> Düsseldorf, Londres et Paris, ce sont les villes par lesquelles est passé Africa Remix, une exposition d'art contemporain du continent africain. Dans quelques semaines ce sera au tour de Tokyo et de Johannesburg de la recevoir... >> Entretien avec Simon Njami, le commissaire de l'exposition. Il nous donne sa vision de l'art contemporain du continent africain.
Masques Dogons, Bamoum, Songye, Senoufo, rites, mythes... bref, l'art traditionnel, voilà ce qui vient souvent à l'esprit lorsque l'on parle d'art du continent africain en général. Et pourtant la production artistique ne se limite pas à cela sur ce continent. Comme dans les autres contrées, une production contemporaine est présente mais, à la différence que celle-ci n'est pas toujours très visible ni en Afrique ni sur les autres continents... Simon Njami, commissaire indépendant, fait partie de ceux qui veulent faire découvrir la richesse et la diversité de l'art contemporain du continent africain, de la peinture aux installations vidéos. Il veut aller au-delà des stéréotypes qui collent à l'art africain, et faire avant tout connaître des artistes... un moyen pour cela: une exposition, et sa dernière s'appelle Africa Remix. Au travers de cette exposition, c'est surtout sa vision de l'art contemporain du continent africain qu'il nous livre. Un continent source d'authenticité?Africa Remix, le titre de l'exposition donne le ton... Parler d'une Afrique remixée c'est s'attaquer d'emblée à un cliché qui a la vie dure, celui d'un continent authentique, d'un continent qui serait source et ressources inépuisables d'authenticité pour les Occidentaux. Vers une reconnaissance de l'individuCette tendance à massifier l'Afrique se retrouve dans beaucoup d'expositions. Les artistes africains sont souvent cantonnés dans des expositions collectives consacrées uniquement à l'art de ce continent, comme si cela était gageure d'une certaine unité artistique, comme si les oeuvres présentées lors de ces expositions étaient représentatives de tout l'art d'un continent. Africa Remix n'échappe pas à la règle de l'exposition collective, 84 artistes provenant des 4 coins du continent, plus de 200 oeuvres rassemblées... Mais Simon Njami dit avoir regroupé volontairement les artistes africains pour montrer, à la différence de beaucoup d'expositions d'art de ce continent l'absence de liens entre des artistes d'un même pays, pour prouver qu'un même thème peut être traité de manière très différente d'un artiste à l'autre. Montrer des individus et pas un groupe, c'est une étape vers la reconnaissance de l'artiste, et peut-être cela aboutira-t-il, à l'instar de l'Occident, à des expositions individuelles d'oeuvres d'un artiste africain... Pas d'aspect primitif dans le oeuvresImpossible de définir "une esthétique africaine" et impossible également de trouver dans cette exposition ce que beaucoup attendraient: il n'y a rien de "primitif", de "premier", rien de "magique" dans les productions artistiques. Le temps où l'africanité était revendiquée par les artistes est révolu. Si au sortir de la colonisation, il était de bon ton de se démarquer fortement des Occidentaux. Aujourd'hui, l'artiste africain n'entend plus rien prouver par son travail. L'enjeu est ailleurs. Il n'est plus essentiellement ethnique, même si personne ne peut renier ses racines et l'influence du milieu dans lequel on vit. A la recherche d'exotisme!Qu'un artiste africain soit concerné par les mêmes problèmes qu'un artiste occidental semble gêner certains commissaires d'exposition. Certains aimeraient que la mondialisation, la globalisation n'ait pas atteint l'Afrique. Qu'on puisse trouver un art totalement différent, exotique, qui refléterait l'image qu'ils se font de l'Afrique. Un art que beaucoup s'evertuent à nommer "art contemporain africain", comme pour mieux le différencier de l'art contemporain! Un manque d'infrastructure aux mains des AfricainsSi le public se fait parfois une fausse idée de l'art contemporain du continent africain c'est peut-être aussi parce qu'il a rarement l'occasion d'y être confronté. Les artistes africains sont peu invités dans les expositions d'art contemporain même si cela commence peu à peu à changer. En outre, bien qu'une biennale d'art contemporain soit organisée à Dakar, l'Afrique manque cruellement d'infrastructure pour la promotion de l'art. Conséquence: les artistes africains dépendent des structures occidentales. Une position difficileIl reste encore un long travail à faire sur le regard porté sur l'art contemporain du continent africain. La position des artistes africains n'est pas facile: vu dans l'altérité en Occident mais aussi en Afrique, car beaucoup d'africains ne se sentent pas concernés par l'art de leurs compatriotes.
Homos, hétéros: égaux devant la loi?
>> Pour Tels Quels, une association de gays et de lesbiennes, c'est la fin sur le plan juridique d'une série de luttes en Belgique pour les droits des homosexuels, mais le début d'une lutte pour les droits des gays et des lesbiennes en Afrique et en Asie.
Un enfant adopté par un couple gay. Ce sera désomais bientôt possible. Vendredi 2 décembre 2005, tard dans la nuit, la Chambre a voté la loi sur l'adoption pour les couples homosexuels. La fin d'un long combat« Juridiquement, le combat des gays et des lesbiennes pour une égalité des droits en Belgique par rapport aux hétérosexuels touche à sa fin », c'est en tout cas l'avis de Michel Duponcelle, coordinateur de l'association pour gays et lesbiennes "Tels Quels". La lutte pour une équité des droits avait commencé par la Loi Moureau qui a été adaptée en 1999 et qui rend punissable la discrimination envers les homosexuels. En 2003, c'est le mariage entre deux personnes de même sexe qui devient légal. Et maintenant, c'est l'adoption qui va être possible pour les homosexuels. Une série de droits obtenus mais qui n'empêchent pas l'homophobie d'être toujours présente. Pour Dan Lelarge, secretaire de l'antenne régionale 'Tels quels-Verviers', «malgré l'évolution du public par rapport à l'homosexualité qui a beaucoup changé en 30 ans, il y a quand même encore beaucoup d'homophobie à l'état latent. L'insulte 'sale pédé', 'sale gouine', sont des expressions que l'on entend encore souvent. Ça peut être choquant et c'est blessant de toute façon». L'asbl "Tels Quels" est bien consciente de ce problème. C'est en faisant des actions auprès du public au travers de toute la Communauté française et en donnant une image positive de l'homosexualité que l'association tente de lutter contre l'homophobie. Pour Michel Duponcelle « c'est la méconnaissance du 'mode de vie' des homosexuels qui mène aux préjugés. En montrant que nous sommes Monsieur et Madame tout le monde qui simplement n'aimons pas une personne de l'autre sexe, et bien nous montrons que l'homosexualité n'a pas besoin d'être un mode de vie qui interpelle, qui fait peur. Nous sommes simplement des hommes et des femmes qui partageons avec les hétérosexuels l'espoir d'avoir une vie de couple stable, épanouissante, d'avoir des enfants, de fonder une famille». A cela vient s'ajouter un autre combat de "Tels Quels", le droit des homosexuels en Afrique et Asie, deux continents sur lesquels la discrimination à l'égard des gays et des lesbiennes est forte, et pour lesquels, il n'existe encore aucun droit.
Site Internet de l'association : https://telsquels.be/.
La France de la diversité de A à ZOUZ
Depuis son enfance dans un bidonville de la région lyonnaise,jusqu'à aujourd'hui, en tant que Ministre du gouvernement français délégué à la promotion de l'Égalité des chances, Azouz Begag a lutté pour le droit à l'intégration et à la diversité. Pour lui tout d'abord, et ensuite pour tous ceux qui comme lui ont du « se battre pour s'en sortir et exister »
Vas, vis et deviensLe 12 décembre dernier, au Centre culturel de Libramont, Azouz Begag répondait à l'invitation du Département des Affaires économiques de la Province de Luxembourg pour une conférence/débat intitulée «Va, vis et deviens». Animée par Jacques Bredael, cette conférence a été l'occasion pour lui de faire le point sur une vie passée à lutter contre les discriminations. Sortir du bidon d'huileAzouz Begag n'est pas un homme politique à proprement parler. Sociologue, romancier*, professeur, chercheur, scénariste pour la télévision, il fait partie du gouvernement français sans être un élu du peuple. « J'ai des lecteurs, pas des électeurs», aime-t-il préciser. Né en 1957, dans la banlieue de Lyon, Azouz Begag, enfant de l'immigration algérienne, a vécu dans un bidonville durant les dix premières années de sa vie. Ses parents avaient rejoint la France pour trouver du travail. Ils ne parlaient pas français et ne savaient ni lire ni écrire. Aujourd'hui il est le premier Ministre français issu de l'immigration maghrébine. « Un jour un enfant à qui j'ai dit que j'étais né dans un bidonville a écarquillé les yeux devant moi et m'a dit: 'Tu es né dans un bidon d'huile? Comment tu en es sorti? '. Et je lui ai expliqué que c'était par l'école. J'ai trouvé comment ouvrir le bidon et je me suis échappé comme un génie. » Apprendre pour surmonter les humiliationsC'est donc grâce à l'École de la République et à l'apprentissage de la langue qu'il considère comme « un passeport pour l'intégration » qu'il a pu « monter dans l'ascenseur social ». Une motivation, une hargne même, qui naquit des humiliations subies dans son enfance. La puissance de la langue pour déjouer la discriminationIl se lance donc dans une véritable frénésie d'apprentissage: un bac en électrotechnique pour commencer, puis un doctorat en sciences économiques. Il deviendra chercheur au CNRS où il travaillera beaucoup sur les questions des difficultés des jeunes issus de l'immigration maghrébine et sur les questions de l'intégration et de l'identité. Il mène par ailleurs une carrière en tant que romancier,avec en 1986 la parution de son premier livre, Le Gone du Chaâba, dans lequel il raconte son enfance. L'arabe qui cache la forêtAzouz Begag sera même fait Chevalier de la Légion d'honneur!Mais si il est devenu un emblème pour une génération de jeunes issus de l'immigration, il refuse toutefois d'être, selon ses termes « l'arabe qui chache la fôret ». Place à la richesse de la diversitéDevenu aujourd'hui ministre, il continue le combat pour la diversité, pour « une France des couleurs », à travers des actions très concrètes de sensibilisation des entreprises, du grand public et du monde politique. Rappelons qu'il s'est opposé à Nicolas Sarkozy, un collègue de gouvernement, sur les mots utilisés lors de la récente crise des banlieues: racaille, nettoyage au Karcher... Il s'agit donc non seulement d'un combat culturel mais aussi politique. Cette révolte des gens qui disent nonDans sa chambre, Azouz Begag garde deux photos qui ne l'ont jamais quitté depuis son enfance et qui sont emblématiques pour lui. « La première a été prise aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. C'est sur un podium. Il y a trois places. Les deux Noirs américains qui viennent de gagner ont le poing levé avec des gants noirs. C'était une telle puissance pour moi de voir que des américains noirs en 1968 - Martin Luther King venait d'être assassiné - au moment de l'hymne national américain, bafouent cet hymne en disant non à la ségrégation des Noirs aux Etats-Unis. J'en ai une autre aussi du boxeur Cassius Clay, Mohamed Ali. Lui, dans la même période aussi, ça m'avait beaucoup troublé, disait 'moi je ne vais pas faire la guerre au Vietnam. Pourquoi irais-je tuer des vietnamiens dont je n'ai jamais entendu parler alors qu'il y a tellement de mes frères Noirs américains qui sont dans les situations dramatiques, dans les ghettos pouris de toutes les grandes villes américaines?'. Cela m'a vraiment marqué cette révolte des gens qui disent non, de ces hommes révoltés qui tout d'un coup se lèvent et disent non.» Bibliographie sélective parmi 40 livres écrits:
Remerciements:Nous tenons à remercier le Département des Affaires économiques de la Province de Luxembourg pour cette belle initiative et pour leur autorisation de diffuser quelques extraits de cette conférence.
Abstraction au coeur de La Docherie>> Une fresque pour donner de la couleur au quartier de la Docherie, près de Charleroi. >> Une façon de sensibiliser la population à l'art et de déplacer la culture du centre vers la périphérie.
Cette fresque c'est le résultat de l'Opération Couleur Quartier qui a eu lieu en 2004. Cette Opération est née de la collaboration entre les actions de quartiers du CPAS de Charleroi et le centre culturel régional. Un des buts était d'inviter les gens de la Docherie à redonner de la couleur à leur quartier. Il s'agissait de faire participer tous les habitants, mais pour cela il fallait trouver un moyen de les attirer.
Concrètement cette fresque a été réalisée à partir des différentes peintures conçues par les habitants de la Docherie. Ces dernières ont été créées lors d'ateliers encadrés par l'artiste peintre Jean-Luc Urbain. Chaque atelier s'est déroulé de la manière suivante: après un bref aperçu de l'histoire de l'art expliquant en quelques mots le passage du figuratif à l'abstrait, Jean-Luc Urbain, mettait au travail les artistes d'un jour. A partir d'une photo en rapport avec le quartier, chaque participant avait pour mission de produire sa propre peinture. Ces peintures abstraites sont une façon de faire comprendre aux gens la déconstruction du figuratif opérée par certains artistes. Une façon de rendre l'abstrait moins abstrait! Et expérimenter la création artistique, ça peut donner l'envie de s'y intéresser.... Une fois toutes les oeuvres réalisées, c'était au tour des peintres en bâtiment de la Régie de Quartier d'entrer en scène. Sous la direction de Jean-Luc Urbain, ils ont peint la fresque à partir des différentes peintures produites par les habitants de la Docherie. D'autres peintures ont été disséminées le long du chemin entre le la Docherie et le centre culturel de Charleroi. Une façon de montrer qu'il se passe aussi des choses à la Docherie, d'attirer les gens du centre de Charleroi vers la périphérie pour y découvrir une fresque monumentale.C'est aussi une manière de redorer le blason de ce quartier parfois oublié et un début peut-être de décentralisation des activités culturelles.
Nous avons largement fait écho dans Intermag aux thèses défendues par Alain Touraine dans son dernier ouvrage Un nouveau paradigme pour comprendre le monde d’aujourd’hui.
Selon l’auteur, les changements observables dans les sociétés contemporaines nous obligent à modifier le regard que nous portons sur elles : nous devons désormais adopter un paradigme non social pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. En filigrane de ce raisonnement se trouve posée la question d’une redéfinition des mouvements sociaux, puisque le conflit structuré et structurant mené par la classe ouvrière contre le patronat s’inscrivait pleinement dans un paradigme social. Alain Touraine a souvent posé la question de savoir si l’on pouvait repérer l’émergence d’un nouveau conflit central dans la société globalisée qui est la nôtre (et qu’il a souvent appelée société programmée pour en indiquer le mode de pouvoir) et il a défendu l’hypothèse que ce conflit portait sur la défense de la liberté du sujet personnel. Nous voudrions dans ce texte tenter de voir à quelles luttes concrètes correspond éventuellement ce conflit central – et donc voir si l’on peut définir au moins partiellement quels sont les objets de ces luttes, leur nature, leurs protagonistes, leurs modalités.
Quelle cohérence derrière ces luttes?
|


 Simon Njami est commissaire indépendant et consultant en Arts visuels auprès de l'Association française d'action artistique (AFAA). Il a entre autres organisé en 2001, 2003 et 2005 les rencontres de la photographie contemporaine à Bamako. Il est également critique d'art et co-fondateur de la "Revue noire"
Simon Njami est commissaire indépendant et consultant en Arts visuels auprès de l'Association française d'action artistique (AFAA). Il a entre autres organisé en 2001, 2003 et 2005 les rencontres de la photographie contemporaine à Bamako. Il est également critique d'art et co-fondateur de la "Revue noire"




 >> La loi autorisant l'adoption par des homosexuels a été votée par la Chambre le 2 décembre dernier.
>> La loi autorisant l'adoption par des homosexuels a été votée par la Chambre le 2 décembre dernier.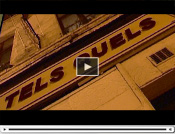





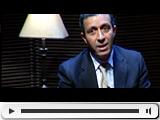

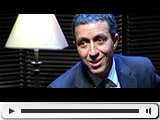
 La Docherie, un quartier de la banlieue ouest de Charleroi. Des maisons en brique rouge, des rues étroites, des terrils... et une fresque de 24 m2, réalisée par les habitants de la docherie.
La Docherie, un quartier de la banlieue ouest de Charleroi. Des maisons en brique rouge, des rues étroites, des terrils... et une fresque de 24 m2, réalisée par les habitants de la docherie.


